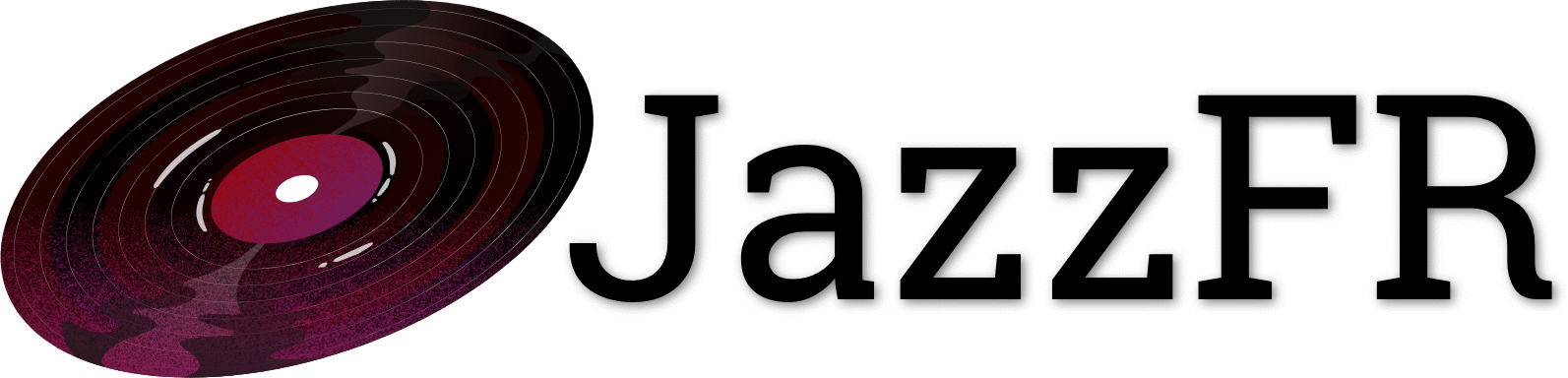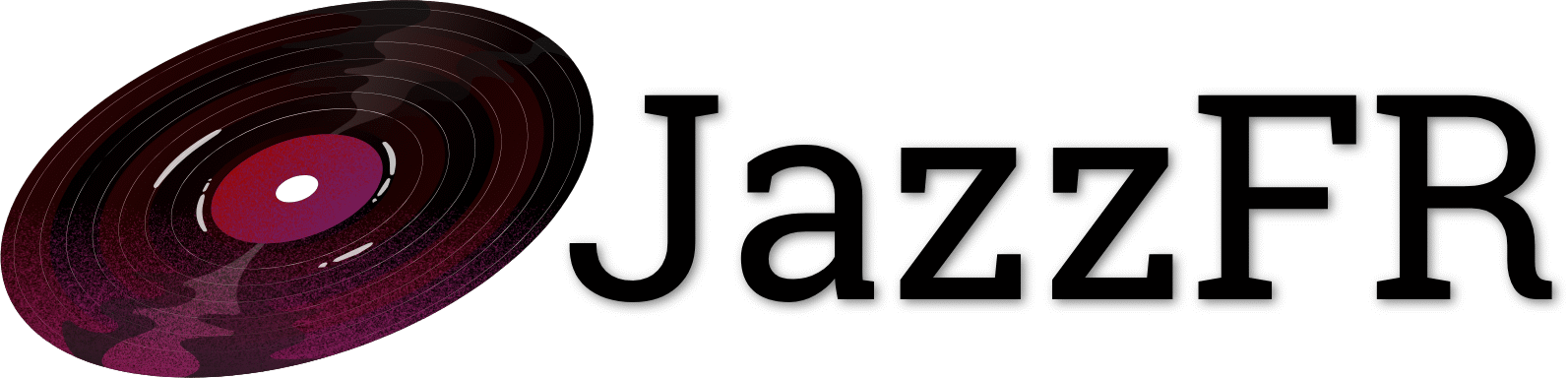« À l’époque, on ne se rendait pas compte de ce qu’on avait fait : on passait vite à autre chose. (...) C’est après, en réécoutant, que je me disais que c'était vachement bien… ou bien très nul ! »
Voici ce que m’a dit Christian Padovan, bassiste parmi les plus enregistrés de France. Il a joué avec toutes les plus grandes figures de la variété française (Berger, Gall, Sanson, Balavoine, Sardou, Johnny, ainsi que bien d’autres à n’en plus finir) et constitue l’un des plus importants représentants d’un métier aujourd’hui quasiment disparu : musicien de studio. Cette race rare mais mythique de professionnels de l’enregistrement accompagnait en studio tous les plus grands artistes de la chanson française, pouvant enregistrer une dizaine de titres par jour, en étant toujours efficace et au service de la musique.
Padovan a été aussi prolifique que discret : s’il a donné très peu d’interviews au cours de sa carrière, son nombre de crédits se compte par milliers. C’est à l’occasion de la tournée « Balavoine : Ma Bataille », réunissant certains des musiciens historiques du chanteur dans le but de lui rendre hommage, que j’ai pu rencontrer celui qui participa à créer des dizaines, si ce n’est des centaines, de singles dont tout le monde se souvient, mais paradoxalement sans connaître les musiciens qui les ont construits.
S’il a maintenant plus de soixante ans de carrière, Christian Padovan n’a rien perdu de son habileté à la basse, comme il a pu le prouver dans un concert musicalement parfait, pendant lequel il interprète certains des plus grands succès de Daniel Balavoine avec la basse Music Man qu’il utilisa pour enregistrer nombre de morceaux dans les années 1970 et 1980.
Si nous sommes revenus sur quelques-uns des moments les plus marquants de sa carrière, il a été également question de quelques albums devenus cultes, comme celui du quartet C.C.P.P. ou encore de son groupe, le Système Crapoutchik.
Entretien
Q : Qu’est-ce que ça fait, pour un musicien qui, comme vous, a joué sur des centaines de projets différents, de revenir sur la musique que vous avez enregistrée 40 ans plus tôt avec ce spectacle en hommage à Balavoine ?
C : Ça fait que, de temps en temps, on est d’accord avec ce qu’on avait fait à l’époque et, d’autres fois, on ne l’est pas. Mais il y a certaines chansons où on ne peut aujourd’hui plus rien changer : c’est comme si les Beatles changeaient tout l’arrangement de morceaux que le monde entier connaît. Balavoine, c’est pareil : on ne peut pas changer fondamentalement une œuvre pareille. On change dans le détail : on se demande par exemple pourquoi j’en ai fait beaucoup à ce moment-là alors que j’aurais dû en faire moins. Mais c’est ça qui est bien en musique : c’est toujours ouvert. Les œuvres évoluent, elles ne sont pas immortelles. Pour cette tournée, ce qu’on fait est vraiment pas mal : on respecte à la fois ce que Balavoine voulait faire tout en ajoutant notre évolution en tant que musiciens.
Q : Au vu du nombre d’enregistrements que vous avez faits, est-ce que vous vous définiriez comme un requin de studio ?
C : Oui, mais ça dépend comme on l’entend, si c’est péjoratif ou pas. Dans le métier, on nous appelait les requins, mais nous étions simplement des professionnels de l’enregistrement. Dans l’esprit des gens, il y avait toujours l’amalgame entre ceux qui avaient fait les enregistrements originaux et ceux qui accompagnaient l’artiste. C’est faux ! En général, c’étaient des gens spécialisés dans l’enregistrement, qui pouvaient lire la musique et aller vite ; et puis il y a ceux qui accompagnaient sur scène, qui étaient des gens différents : des copains, un orchestre… Musicien d’enregistrement, c’est une profession à part. On peut dire requin, mercenaire… musicien de studio ! La plupart du temps, on ne savait pas pour qui on allait enregistrer. On nous disait : tel jour, telle heure, tu es libre, par exemple de 13 h 30 à 20 h au studio Pathé Marconi, mais on ne savait pas pour qui on allait enregistrer : on y allait simplement. C’était un régisseur ou un chef d’orchestre avec qui on avait l’habitude de travailler qui nous appelait. Je me suis retrouvé avec Tino Rossi ou Charles Trenet ! Et j’ai dit : « Ah bon ! » Je ne le savais même pas.
Q : Moi, je vous ai connu en regardant le nom sur les pochettes des albums, et vous revenez très souvent.
C : Oui, avec le temps, on se rend compte qu’on en a fait beaucoup. Il y a une époque où, à la Spedidam (société qui s’occupe des droits des professionnels de studio), on nous demandait des justifications pour créditer des œuvres à son nom. Quand j’ai commencé, la plupart du temps, il n’y avait pas les crédits sur les albums : par exemple avec Jacques Dutronc. J’avais fait deux albums avec lui et pas mal de singles, dont « Il est cinq heures », j’ai commencé par là ! Heureusement que j’ai pu aller le voir et lui faire remplir une attestation pour justifier ma présence sur tous ces enregistrements. Ensuite, ils ont commencé à mettre les noms sur les pochettes. J’ai eu de la chance avec Véronique Sanson, car ils ont mis les noms, en petits… mais ils existent ! À partir du moment où on a mis les noms sur la pochette ou sur la rondelle du disque, on n’avait plus besoin d’emmener un justificatif à la Spedidam. Au début des années 1970, ce n’était pas systématique d’avoir le nom des gens qui ont participé. Mais je suis passé à travers pas mal de crédits, des enregistrements pour lesquels je n’ai pas pu justifier que j’étais là. En plus, à cette époque, il fallait le titre de l’œuvre enregistrée : comme on en enregistrait parfois dix dans la journée (une séance de trois heures faisait quatre titres en général), on était incapable de savoir ce qu’on enregistrait. On était des mercenaires, comme on dit !
Q : Vous parliez de vos débuts avec Dutronc, mais vos vrais débuts se passent avec Gérard Kawczynski et les Challengers !
C : (À propos du surnom « Crapou » donné à Kawczynski) En fait, précisément, c’est Jacques Volson, qui était le producteur de Dutronc, de Françoise Hardy, de Johnny Hallyday, chez Vogue, qui n’arrivait pas à prononcer Kawczynski. Donc il l’appelait Clafouti, etc. Puis c’est devenu Crapoutchik. Après, on a fait, en parallèle de Dutronc, le Système Crapoutchik, du nom estropié de Kawczynski. On a eu un succès d’estime, et ils ont fait une compilation de ce qu’on avait fait…
Moi : Oui, Claude Puterflam a sorti « Flop », qui est un condensé de tout ce qu’avait fait le Système.
C : Ah bah “Flop” ça veut tout dire! C’est l’ensemble de tout ce qu’on a floppé! Mais il y a eu un album en 1975 qui est vachement bien.
Moi : C’est un de mes albums préférés.
C : J’en renie beaucoup, mais pas celui-là. Ça, c’est top ! C’est Puterflam qui a dit : « Bon, ça fait cinq ans qu’on a arrêté, on va essayer d’en refaire un. » Celui-là est bien, moi je trouve, parce que c’est pop quelque part !
Les Challengers, en 1964, interprétant « Marie-Line ».
« All what I have » du Système Crapoutchik, sur la compilation « Flop »

Q : Comment s’est initié l’album du Système Crapoutchik de 1975 ?
C : On avait continué avec Gérard [Kawczynski] à faire beaucoup de séances d’enregistrement. On a travaillé avec Sanson, avec Berger… Et comme Puterflam venait de créer son Studio Gang, il nous a demandé pourquoi on ne referait pas un album. Ça s’est fait au détour de notre travail de studio. C.C.P.P., c’est pareil : c’est un tas de musiciens de studio, on se voyait régulièrement à l’époque pour accompagner des gens sur disque. On s’est dit : « Pourquoi on ne ferait pas un truc à nous ? » pour se changer la tête. Puterflam nous a demandé de venir un week-end pour enregistrer entre copains.
Q :Michel Berger a dit à propos du Système Crapoutchik : « C’est un drame musical, le flop du Système Crapoutchik : c’est une équipe de musiciens qui avaient un talent fou, qui voulaient faire quelque chose de nouveau en France, mais c’était trop tôt et ça n’a pas marché. ». Qu’en pensez vous ?
C : C’est vrai qu’on dit toujours « trop tôt » quand on ne sait pas quoi dire : on dit « trop avancé », « trop évolué », ça ne veut pas dire grand-chose… Avec le recul, je pense qu’il manquait quelque chose pour que ça passe les limites du populaire. C’était trop, il n’y avait pas de concessions là-dedans. Il n’y avait pas couplet-refrain-couplet, etc. ; on faisait ce qui nous passait par la tête. Sur les textes, on a été interdits de passage à la radio, sur « Je t’aimais », et je ne peux pas leur donner tort : passer ça à la radio, ce n’est pas possible. Mais sur le moment, nous, on chantait ! C’est Claude Puterflam qui a écrit les textes, mais on s’est rendu compte qu’on ne passerait pas à la radio avec ce titre-là.
Q : D’ailleurs, c’était Michel Berger qui vous a mené sur toutes les premières productions de Véronique Sanson, de Françoise Hardy et de France Gall. Comment était-il ?
C : C’était quelqu’un qui savait composer et qui savait très bien où il voulait en venir. Ce n’était pas quelqu’un qui écrivait la musique : il composait, mais il ne l’écrivait pas sur le papier. On se retrouvait souvent chez lui, rue Jouffroy [XVIIᵉ arrondissement de Paris], et on écrivait des grilles d’accords, pas des notes mais des harmonies. Puis, en studio, chacun trouvait ses idées. Mais il n’y a pas que lui : Balavoine, c’est pareil. Ce n’étaient pas des gens qui écrivaient la musique : ils composaient une grille d’accords. Toutes les idées, c’est nous qui les trouvions.
Q : En effet, Michel Berger a déclaré la chose suivante : “Que l’amour est bizarre a été entièrement réalisé avec le Système Crapoutchik […] Quand je suis rentré en studio, je n’avais presque rien de préparé. […] Michel Bernholc a fait deux ou trois passages de cordes, mais à part cela, ce fut exclusivement un travail de groupe. C’est l’album d’un groupe.”.
C : C’était toujours comme ça ! Je me souviens que j’avais du mal à faire valoir une ligne de basse à laquelle je tiens beaucoup : « Ça balance pas mal à Paris ». Quand je la réécoute, ça m’étonne encore. On avait arrêté de travailler ensemble pour des raisons X (nous ne sommes pas restés en termes exceptionnels) et je n’allais pas l’appeler pour lui demander une attestation. J’ai réussi à trouver quelqu’un qui atteste que c’était bien moi sur le disque. C’était même Crapou [Gérard Kawczynski] qui jouait sur ce titre : quand on écoute, c’est spécial.
Moi : Je vous ai découvert avec la ligne de basse de « La Bonne Musique » [Michel Berger – sur l’album Mon Piano Danse].
C : Elle est vachement bien ! « Ciénéga » aussi est vraiment bien. Chacun faisait ce qu’il voulait là-dedans : rien n’était défini. C’est ça qui est formidable. Puis on se rend compte, à la fin du morceau, que ce qu’on joue a beaucoup changé par rapport au début. C’est bien : c’est très spontané. En fait, le grand maître de tout ça était Michel Bernholc [arrangeur]. Il savait écrire des rythmiques simples, mais surtout des cordes. Françoise [Hardy], avec qui on a fait Message personnel, disait qu’à l’époque il y avait des orchestrateurs qui savaient écrire des cordes : elle a raison ! Sanson, c’est l’exemple type : c’est la rencontre d’autodidactes avec des gens qui savent musicalement. Pour moi, Sanson est la première entrée pop dans la chanson française ; c’était quelque chose de nouveau. Même nous, à l’époque, on ne se rendait pas compte de ce qu’on était en train de faire, mais quand mes enfants réécoutent ça, ils me disent : « C’est vachement bien. » Et oui, c’est vachement bien parce que ça n’avait jamais été fait : jamais ! Je suis assez content de ça : les chansons sont tellement magnifiques, mais c’est surtout la façon de les faire. Message personnel, personnellement, ça m’émeut toujours. De même avec « Première Rencontre ».
Q : On en revient encore au Système Crapoutchik et au morceau « Judy », sur lequel il y a un break à l’orchestration magnifique.
C : Oui ! C’est Bernholc ! Il a même écrit les lignes de basse. On a fait toutes les rythmiques en studio et puis il a rajouté ces cordes. Mais ce dialogue entre ces phrases de cordes et ces guitares doublées qui répondent, c’est « beatlesien » à mort ! Tu entends, tu fais : « Waouh, ça le fait ! » Même « Judy » est un clin d’œil à « Hey Jude ». À l’époque, un journaliste nous a dit : « Vous êtes en train de vous dévoyer. » Je ne comprenais pas ce qu’il me disait. En fait, il trouvait ça un peu simpliste.
Q : Vous avez fait vous-même des orchestrations pour Julien Clerc.
C : Oui, j’ai fait « Partir », qui est un très bon souvenir. Mais qu’est-ce que c’est mal mixé ! J’en veux à Dominique Blanc-Francard pour ça : je trouve qu’il n’a pas fait le boulot. Quand j’écoutais ça en studio, c’était énorme ! Je me souviens qu’on avait fait ça au Studio Aquarium et le son était vraiment énorme, alors que quand j’ai écouté le disque, c’était devenu tout petit : il avait mis des « limiters » partout. Je ne peux plus écouter « Partir » ! Je suis déçu à un point… Je trouve que le travail qu’on a fait n’est pas mis en valeur, car on peut avoir les meilleurs musiciens du monde, si ce n’est pas réalisé par un ingénieur du son digne de ce nom, c’est foiré ! Un mauvais son arrive plus souvent qu’on ne le croit. On se dit : « Ah bon ! » J’avais fait un album pour Geneviève Paris [Entre le vert et le gris] à cette époque-là : elle avait beaucoup de talent et il y avait des bons ! Ceccarelli, Gérard Bikialo… Mais encore une fois : Blanc-Francard ! Je suis déçu, mais je ne suis pas le seul : Denys Lable m’a fait la même réflexion. Blanc-Francard est un escroc quelque part. Ça tient à peu de choses ! Parce que j’aime bien le travail qu’on a fait, mais je ne peux pas écouter ça à cause du son.
« Judy » du Système Crapoutchik, avec une orchestration écrite par Michel Bernholc.
« Partir » de Julien Clerc, avec une orchestration de Christian Padovan et Gérard Kawczynski

Q : Pour revenir sur la spontanéité : quelle était votre approche quand vous entamiez une session en tant qu’accompagnateur ?
C : La plupart de ce qu’on a fait en studio pour les autres (pas pour Berger ou ces gens-là) était écrit. Tout était écrit. Même avec Sanson, Bernholc avait tout écrit.
Moi : Vous avez rejoué avec Sanson sur Vancouver.
C : Oui, j’étais parti à Londres pour l’occasion.
Moi : Ce que vous faites sur Vancouver est vraiment extraordinaire
C : Sur Vancouver, oui. Ce n’était pas écrit, c’est une invention totale.
Moi : On y retrouve la même patte que quand vous jouiez avec Michel Berger…
C : C’est ça ! Je jouais avec une Rickenbacker. Mais surtout, c’est une façon de composer qui mène à jouer comme ça. Finalement, Véro, c’est toujours un peu dans le même style, même si c’est sophistiqué et que ce n’est pas de la « variétoche ». D’ailleurs, une anecdote : quand Stephen Stills a écouté le premier album de Sanson, il n’a cité qu’un musicien : André Sitbon [batteur du Système Crapoutchik]. Il a dit : « Voilà un batteur. » C’était quelqu’un qui avait beaucoup de technique, mais qui n’aimait pas la démonstration.
Q : Dans les années 1970, vous aviez un son qui était reconnaissable entre mille.
C : J’ai joué longtemps au médiator, puis j’ai abandonné parce que je trouvais que ça réduisait le son, et maintenant j’ai du mal au médiator !

« Joris of Lumina », composé par Christian Padovan pour C.C.P.P
Q : En parallèle de votre travail de studio, il y a le groupe C.C.P.P., qui a produit un disque devenu culte. Comment cette réunion des meilleurs professionnels de studio de l’époque s’est-elle faite ?
C : Ça s’est fait au détour de notre travail de studio. Entre musiciens de studio, on se voyait régulièrement à l’époque pour accompagner des gens sur disque. On s’est demandé : « Pourquoi ne pas faire un truc à nous ? », pour se changer les idées. Puterflam nous a demandé de venir un week-end pour enregistrer entre copains.
Moi : Cet album-là a été fait en un week-end ?
C : Complètement ! C’est fou ! On était quatre, chacun avec deux morceaux, où on avait écrit ce qu’on voulait d’absolument nécessaire musicalement, et des parties où on laissait libre cours à chacun. Les rythmiques des huit titres ont été enregistrées en un week-end. Puis ensuite, on a enregistré les cuivres en re-recording la semaine d’après. Il n’y a pas longtemps, j’étais avec Claude et on discutait de cette époque-là. Puterflam est un déjanté : pour lui, la musique, c’est déjanté, c’est un déconneur fou. Il n’écoute pas de musique instrumentale : il n’écoute ni musiciens ni virtuoses, ça ne l’intéresse pas. Je lui ai demandé pourquoi avoir fait C.C.P.P. Il m’a répondu candidement : « C’était pour vous faire plaisir. » C’est génial ! Il était content de nous faire plaisir. C’est dommage qu’il n’y ait pas eu de suite à C.C.P.P., ni de scène.
Moi : J’aime beaucoup la composition que vous avez apportée à l’album, « Joris of Lumina ».
C : Ce morceau a été indicatif RTL ! Avec Crapou, on était copains avec Jean-Bernard Hebey, de RTL. Il avait une émission quotidienne à cette époque et il a décidé de prendre ce titre-là comme indicatif. Je ne sais pas si c’était du copinage ou parce qu’il aimait bien, mais bon. Dans C.C.P.P., il y a des morceaux que je trouve spontanément intéressants, mais en plus, je n’ai pas souvenir qu’on se soit dit : on va faire tel genre ou tel autre style. On ne s’est pas concertés. On a juste dit : on enregistre ! Mais quel style ? Tout est venu spontanément. Il y a un type qui a ressorti ce disque-là en pirate : Vadim Productions.
Moi : J’ai moi-même le disque Vadim.
C : Ça, c’est du piratage ! Ceccarelli m’a appelé en me disant : « Ça ressort ! » Je me suis dit : « Puterflam s’est décidé à le represser, c’est super ! » Naïvement, je croyais que c’était Claude qui avait ressorti ça. On était au restaurant ensemble et je lui ai dit que c’était génial qu’il ressorte tout ça. Il m’a répondu : « Mais qu’est-ce que c’est que cette histoire ? » Je croyais qu’il plaisantait, mais non, il n’était pas au courant. C’était du piratage de A à Z. On le voit bien à la photo : les couleurs sont passées, elles sont mal foutues. Mais même la rondelle intérieure : c’est Flamophone ! Vadim a tout piqué ! Ils ont sorti 500 vinyles et 500 CD qui sont partis en moins d’un mois… Le type qui a fait le piratage, sur le CD, a écrit des notes sur le livret qui sont très bonnes néanmoins.
Moi : Il faut quand même dire qu’il n’y a que cette édition qui est disponible en physique : l’original se vend plusieurs centaines d’euros.
C : Oui, mais c’est un peu toujours la même histoire. Comme il n’y en avait pas beaucoup, on en avait pressé peut-être 1 000, la rareté fait le prix. De même pour Crapoutchik : un journaliste m’a dit que le premier album était parti pour 400 euros…
Q : Vous avez également produit quelques albums en solo, sous différents pseudonymes, comme Pado & Co.
C : Oui, mais Pado & Co., ce n’est pas bien. Même mes enfants me disent : « C’est moche », et je leur dis oui. C’était du vite fait. On avait fait ça avec Georges Blumenfeld en se disant : « Pourquoi pas ? » C’est toujours pareil : on faisait tellement de choses pour les autres qu’on se dit : on va faire un « coup ». Les « coups », Padovan les définit comme un incontournable du métier de musicien de studio : « une aventure éphémère, d’une fois, en studio ». « On va faire un disque. » Ah bon, d’accord. « Oui, mais on n’a pas d’argent pour le produire. » Ce n’est pas grave. Mais cet album n’est pas bien. Il est bien gentil, Arthur Simms [chanteur de Pado & Co], mais ce n’est pas de la musique personnelle.
Pareil pour Pantin : c’est une escroquerie, une escroquerie énorme !Avec Julien Clerc, on était allés voir Weather Report à Pantin [au Pavillon de Paris, le 7 juillet 1976]. Ils faisaient une entrée de scène formidable : une demi-heure avant le début du show, ils envoyaient le Boléro de Ravel, mais très peu fort. Dans l’esprit des gens, entendre une musique au lieu du brouhaha habituel des salles faisait que les gens se taisaient et écoutaient. Puis le volume augmentait progressivement pour finalement arriver à un paroxysme de force, jusqu’à ce que les gens soient tétanisés, et là, ils commençaient à jouer « Black Market ». Je me suis dit que c’était génial.
Julien m’a demandé si on ne pouvait pas faire quelque chose comme ça pour préparer les gens avant le spectacle. Je lui ai dit d’accord, alors que je n’y connaissais rien. Finalement, on a enregistré Pantin chez Gang et j’ai fait n’importe quoi ! J’ai écrit des morceaux de riffs au piano, au synthétiseur, ou bien on enregistrait une pédale de basse. Avec le synthétiseur de Georges Rodi, je lui disais : « On va mettre un poids sur le do » : le synthé va faire do pendant quinze minutes, et pendant ce temps-là, on allait prendre un café (rires). On revenait et puis on faisait « do dièse », on mettait une cale et on s’en allait. On a empilé là-dessus des tas de choses et puis, à la fin, ça prenait de l’ampleur. Je m’étais inspiré du Boléro ! On s’est servi de ça avec Julien pendant quelque temps.
Au départ, ce n’était pas prévu pour faire un disque : juste pour diffuser en salle avant un spectacle. Le producteur de Julien, à l’époque, a dit : « On va en faire un disque. » Même moi, j’étais étonné. Je lui ai dit qu’il n’y avait pas de quoi faire un disque avec ça, que c’était une escroquerie ! C’est un conglomérat de plein de notes qui montent en intensité parce qu’on rajoute n’importe quoi au fur et à mesure : c’est du bruit !
« Pantin », un projet solo composé d’un seul titre en deux parties : « Welcome to the Palace »
Q : Dans ce que vous avez fait, quels sont les projets que vous préférez ?
C : Je ne suis pas tendre, en général, avec ce que j’ai fait. Il y a des choses que je réécoute encore : C.C.P.P., je ne renie pas. Je serais incapable de le refaire, comme beaucoup de mes potes de l’époque : on ne peut plus faire ça, ce n’est plus de notre âge. Il faut être un peu fou pour faire ça. Même moi, C.C.P.P., je me demande comment j’ai pu faire ça. Ça me paraît très compliqué. Quand on sait qu’on a fait ça en deux après-midi, en deux prises maximum, avec tout ce qu’il y a de mise en place ! Il y avait des passages ad libitum où on faisait ce qu’on voulait, mais les thèmes étaient totalement écrits.
Aussi, j’aime les Sanson. Je trouve que maintenant je les jouerais mieux, mais est-ce que ce serait mieux ? Pas sûr.
Il y a des titres qui m’émeuvent toujours : Message personnel de Françoise Hardy, Dites-moi de Jonasz. En fait, à l’époque, on ne se rendait pas compte de ce qu’on avait fait : on passait vite à autre chose. Je rentrais chez moi le soir et je ne savais même pas ce que j’avais fait. C’est après, en réécoutant, que je me disais que c’est vachement bien… ou que c’était nul.
Il y a des titres aussi auxquels j’aurais bien aimé participer : avec Serge Gainsbourg, par exemple. J’ai fait « L’Ami Caouette » avec Gainsbourg… (rires)
Moi : C’est déjà pas mal d’avoir enregistré avec Gainsbourg.
C : C’est ridicule ! J’ai écouté, je lui ai dit : « Laisse tomber… » C’était aussi en fonction des équipes avec lesquelles on travaillait. Moi, je travaillais beaucoup avec Slim Pezin, qui n’est plus de ce monde. Il était très fier d’avoir fait des tubes énormes avec Voyage. Il était très fier d’avoir cosigné « Tenue de soirée » avec Serge Gainsbourg, et il peut en être fier ! Moi, j’aurais bien aimé. En fait, de toutes les notes qu’on a pu faire, ce sont les petits détails qui sont les plus importants pour nous, parce que les musiciens qui ont fait ce métier ont souvent été des compositeurs. Moi, j’ai composé quelques morceaux pour Croisille, pour Julien.

C : Mon meilleur souvenir, c’était quand j’ai accompagné Roger Hodgson pour une tournée en France. Carrément, Supertramp ! Quand j’étais avec Julien, à l’époque des walkmans, j’écoutais Breakfast in America en boucle. Un jour, Loïc Pontieux m’a dit que Laurent Vernerey avait un problème et ne pouvait pas faire la tournée française de Roger Hodgson, et qu’il avait besoin d’un bassiste. J’ai relevé toutes les parties chez moi et, quand je l’ai vu arriver, j’ai eu l’impression de voir le Christ ! En plus, c’était un mec en or. Quand j’étais sur scène, je jouais tous les tubes que j’écoutais à l’époque : je n’y croyais pas, c’était fou ! C’était quelqu’un de formidable : il m’envoyait des fax, à l’époque, où il me parlait de sa vie privée comme à un ami. Incroyable !Il connaissait toutes les parties de tous les morceaux de Supertramp, et quand il a constaté que j’avais tout relevé et qu’il a vu Supertramp sur une partition, il m’a dit : « C’est quand même compliqué ! » Je lui ai répondu : « Oui ! » Mais parfois, il me disait : « Là, ce n’est pas tout à fait ça », et après je réécoutais et je me rendais compte qu’il avait raison : il connaissait toutes les parties ! D’avoir fait ça, c’est génial. J’aurais aimé le faire plus longtemps.
Après tout ça, Christian est parti faire les balances pour le concert du soir, après quoi nous nous sommes installés dans un petit bureau du Palais Nikaïa pour continuer de discuter, Padovan bravant sa faim pour continuer à nous parler.
Q : Claude Puterflam a dit que le Studio Gang a bien marché avant tout parce que c’était d’abord un lieu de sociabilité avant d’être un studio d’enregistrement.
C : Claude était un ami de Jacques Dutronc. Il n’est pas musicien, mais est devenu directeur artistique chez Vogue. C’est comme ça que Crapou l’a rencontré et puis, de fil en aiguille, on a fait des choses incroyables avec le Système Crapoutchik, que personne ne saura jamais… sauf vous ! Pour le premier album, on avait tellement peu d’argent qu’on venait la nuit avec Claude Puterflam, qui possédait le double de toutes les clés des studios de la rue d’Hauteville [le studio Sydney Bechet, aujourd’hui Midilive Studio]. Il y avait une cour intérieure et la loge de la gardienne. Nous, on arrivait vers 21 h et on passait avec les instruments sous la fenêtre de la gardienne pour ne pas qu’elle nous voie passer. Puis on avançait, on rentrait dans le studio, on éteignait toutes les lumières. On avait un copain ingénieur du son qui venait et on enregistrait là. On sortait de là au petit matin et on rentrait à pied en banlieue avec nos instruments : ça a commencé comme ça, Crapoutchik.
« Aussi loin que je me souvienne », le morceau titre du premier album concept réalisé en France.
Q : Qui a eu l’idée du concept pour « Aussi loin que je me souvienne » ?
C : C’est Claude. Ca le fait rire quand on lui dit que c’est le premier album concept réalisé ici, en France. Il répond “Ah bon, très bien.”, c’est de la fausse modestie. Suite à ça, comme ça n’a pas marché, de toute façon Claude avait dans l’idée de faire son propre studio. L’histoire du studio Gang était bizarre : c’est un studio qui a brûlé juste avant qu’il ne soit terminé. Il a du tout refaire. On avait une mauvaise plaisanterie avec Crapou, dès qu’on rentrait on disait “C’est bien mais ça sent le brûlé là-dedans”. C’est vrai que c’est devenu un studio culte.
C : Gang, c’est un peu à part, parce qu’il y a eu des studios plus anciens, comme Pathé Marconi (qui n’existent plus), où j’ai croisé les Rolling Stones. Moi, j’allais au travail à 9 h du matin et je vois Keith Richards qui sort du studio, et on était en bas, dans les toilettes, avec le batteur. Il y avait des effluves qui sortaient du studio : ils avaient passé toute la nuit dedans. On a vécu des choses hors du commun ! Pour moi, les années fastes étaient les années 1970-1980, parce qu’ensuite il y a eu le déferlement de tout ce qui était synthétique, et le métier que je faisais en a pris un coup. Tout le monde voulait des basses synthétiques, des claviers synthétiques, etc. Les guitaristes, ça ne les a pas touchés, mais les batteurs, si ! Ils voulaient tous des TR-808 et tout ça… Ça a créé un manque de travail pour les gens de studio.
Q : C’est pour cette raison que vous êtes devenu davantage un musicien de tournée dans les années 1980 ?
C : Je ne voulais plus aller en tournée. J’avais connu trop de galères « alimentaires » en bourlinguant sur la route pour pas grand-chose, parce qu’il fallait vivre. Dès que j’ai commencé à faire du studio et que j’ai compris, je ne suis plus allé sur scène. C’est Julien qui m’a vraiment pilonné pour remonter sur scène. Il avait écouté le Système Crapoutchik, il trouvait ça génial et voulait absolument qu’on l’accompagne sur scène. Je lui ai dit que je ne voulais plus monter sur scène parce que j’avais trop galéré, que j’étais bien en studio. Mais il n’a pas lâché : il m’a pourri la vie ! On a accepté avec Crapou [Gérard Kawczynski], on a monté un groupe avec André Sitbon, qui est un batteur extraordinaire : un métronome ! À l’époque, il n’y avait pas de « click », mais lui avait un métronome intégré dans le cerveau. Avec lui, je n’ai jamais eu de problèmes. Il y a quelques batteurs comme ça : des gens comme Pierre-Alain Dahan ou André Ceccarelli. Dès qu’on va dans une catégorie un peu en dessous, on est moins à l’aise. C’est pour ça qu’en studio, il y a toujours eu des équipes : des gens avec qui les arrangeurs et les orchestrateurs de l’époque avaient l’habitude de travailler et en qui ils avaient confiance.
Q : Vous dites que vous n’avez pas fait beaucoup de tournées et que vous n’aimiez pas ça, mais on vous voit quand même avec Balavoine, Sardou ou bien Johnny.
C : Oui, mais Johnny, ce n’était pas franchement ma tasse de thé. On se connaissait depuis longtemps. On avait enregistré « Gabrielle » ensemble, « Hamlet » aussi. Pareil pour Sardou, on a enregistré « La Maladie d’amour » (rires). Encore une fois, ce n’est pas de la gloriole : c’est le métier qui voulait qu’on fasse tout en même temps. La plupart des gros singles qu’on a entendus dans les années 1970, on en a fait tous une bonne part. Finalement, il n’y a pas tant de musiciens de studio de l’époque : c’était toujours les mêmes ! Quand on regarde les pochettes, on se rend compte que les crédits sont toujours les mêmes. À l’époque, il y avait un tel mélange entre la passion et l’alimentaire… « La Bonne du curé » d’Annie Cordy ! Ceccarelli m’avait dit à l’époque : « J’ai enregistré La Bonne du curé… », l’air gêné. Je lui ai dit : « Bah oui, c’est ton métier ! » Naturellement, ça fait un peu bizarre pour lui. Ceccarelli, ça l’a fait mourir de rire. De même avec Steve Leach et Crystal Grass, dont je me souviens encore très bien. Tous ces trucs-là, c’est ce qu’on appelle des « coups » dans le métier : une aventure éphémère, d’une fois. C’est comme Santa Esmeralda : « Don’t Let Me Be Misunderstood ». Un jour, quelqu’un de ma famille m’a dit : « On t’a entendu sur Kill Bill », j’ai dit : « Ah bon. » Je suis allé voir la Spedidam direct !

Q : Pour revenir à C.C.P.P., le son est extraordinaire !
C : Ça, c’est étonnant ! Je suis entièrement d’accord. Je suis moi-même bluffé par ça. Ce qu’a fait Jean-Pierre Janiaud (ingénieur du son de l’album) à l’époque est vraiment au-dessus. J’écoute des enregistrements de la même époque qui ne sont jamais aussi bien en son. Peut-être que ça vient du fait que ce soit de l’instrumental.
Moi : Oui, mais même des albums instrumentaux de cette époque sont largement moins bien mixés, comme par exemple les premiers albums du Mahavishnu Orchestra.
C : Oui, je suis d’accord, et c’est étonnant. Ça, je peux le réécouter sans problème, alors que beaucoup de ce que j’ai fait me déçoit. La première fois que Janiaud m’a fait une copie CD à partir du vinyle, j’ai tout de suite entendu que le son était extraordinaire. Je lui ai demandé comment il avait fait, s’il avait repris le master original ; il m’a répondu simplement qu’il avait fait une copie du vinyle.
Moi : C’est en partie pour ça qu’il survit aussi bien à l’épreuve du temps.
C : C’est possible, parce que plus d’une fois, des collègues plus jeunes que moi en studio m’ont dit : « Je voulais te dire, C.C.P.P., c’était mon disque de chevet. » Des musiciens très talentueux ! Ça fait plaisir.
Q : Finalement, on revient à l’essence même des musiciens de studio : vous enregistrez quelque chose en deux après-midi et, pour certains, ça reste culte pendant très, très longtemps.
C : Oui, mais alors pour certains, ça peut ne jamais arriver aussi. On peut en faire des tonnes, mais c’est mort. Alors que celui-là, bizarrement, il est toujours là. Je le dis tout le temps à Claude, même si récemment je sens que je deviens lourd, donc j’arrête : « Pourquoi tu ne le ressors pas ? » Il me répond : « Ce disque, on se le garde ! » Je lui dis qu’il est fou ! Vadim en a vendu 1 000 en un mois.
Moi : De même pour Crapoutchik, ils sont presque introuvables !
C : Moi, j’aimerais beaucoup qu’il réédite celui de 1975. Il ne veut pas.
Moi : Il faut le convaincre !